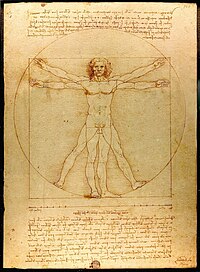http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-segal/segal-analyse.html

Eléments pour une analyse
Movie House, 1966-1967 (Entrée de cinéma ou La caissière)
plâtre, bois, plexiglas, lampes électriques. 260 x 375 x 370 cm
achat de l’Etat 1969, attri. 1976, AM 1976-1018. Centre Pompidou, collection du Musée national d’art moderne
Movie House se présente comme l’entrée d’un cinéma. Dans une cabine rouge qui se découpe sur un fond noir est installée l’effigie d’une caissière. A droite, est construite une vraie porte qui ne conduit nulle part. Le plafond illuminé par 288 ampoules produit une lumière incandescente, soulignant l’effet de dramatisation de la scène.
Une tension entre le fond et la forme
Une composition rigoureuse
La recherche d’un archétype
L’art indissociable de la vie réelle
Situations humainesL’expérience du happening
L’influence du travail de Robert Frank
Une tension entre le fond et la forme 
Cette œuvre repose entièrement sur l’idée de contraste. Segal utilise tout d’abord l’opposition des couleurs : le rouge, le noir et la blancheur fantomatique de la caissière. La texture des matériaux participe également à cet effet de choc : les surfaces lisses et brillantes de la peinture noire et rouge s’opposent à l’aspect mat et brut de la sculpture. Chaque élément intervient dans cette tension entre le fond et la forme. La lumière y joue un rôle essentiel : elle dramatise ce lieu (celui de l’entrée de cinéma qui est aussi celui de l’œuvre d’art) et matérialise cette idée de passage de l’espace de la vie réelle (peut-être celui de la rue) vers celui de la fiction (le cinéma ou tout simplement l’art).
Dans un entretien avec Henry Geldzahler, Quadrum n°19, 1966, Segal s’exprime sur le rôle de la lumière:

[…] Beaucoup de gens ont l’air tellement choqués en voyant une forme réaliste en plâtre blanc, qu’ils ont tendance à fixer uniquement les figures ; ce qui m’intéresse, c’est toute une série de chocs et de rencontres qu’une personne découvre en tournant autour de plusieurs objets placés dans l’espace en relation précise les uns avec les autres […]. La blancheur m’intrigue parce qu’elle évoque une spiritualité désincarnée, pourtant inséparable des détails charnels et corporels du personnage. Mais la couleur m’intéresse beaucoup plus, en elle-même. Pour l’ensemble de la composition, je tire parti de la couleur dont les objets réels sont faits. De plus en plus, la couleur m’attire en tant que lumière plutôt qu’en tant que peinture.


La sculpture en plâtre est une sorte de point focal au sein de la composition.
Une composition rigoureuse 
Segal accorde une attention particulière aux objets et aux structures environnants. Cette dimension relative à la forme et au volume est spécifique aux environnements de cette période. Elle se rattache à un système esthétique apparu au cours des années 60 qui vise à la réduction de la forme à une unité simple. La relation de Segal avec le Minimal art est moins évidente que sa parenté avec le Pop Art et pourtant toute aussi pertinente. Le mobilier réduit à des structures primaires, les couleurs rouge et noire, les surfaces lisses et brillantes, la disposition géométrique des ampoules de
Movie House sont proches de l’esthétique minimaliste de la fin des années 60.
La structure de
Movie House rappelle aussi les compositions orthogonales de Mondrian dans le jeu de rapport entre les zones de couleur et les reliefs. La sculpture en plâtre est une sorte de point focal au sein de la composition. Placée au centre du fond noir, elle apparaît comme une icône au sein d’une chapelle. Les zones réparties de manière symétrique de chaque côté de la cabine sont toutefois légèrement décalées par le léger renfoncement de la porte à droite, accentuant l’idée de profondeur.
Dans ses environnements Segal limite à l’essentiel les accessoires de ce qui forme l’univers d’un travailleur. Il en use avec modération et un sens très sûr de la composition.
Movie House n’est pas la reconstitution réaliste d’une entrée de cinéma, mais plutôt la transposition du souvenir d’une expérience vécue.

Dans mon souvenir ma vie est inséparable des objets. Je regarde les objets sous un jour "plastique" (puisque c’est le terme qui convient), "esthétique", et pour la forme qu’ils représentent. Et les rapports qui existent (ou n’existent pas) entre les gens et ces formes, est quelque chose qui m’intrigue… A condition qu’il y ait eu une relation émotionnelle très vivace entre moi et la personne, ou moi et l’objet, ou moi et les deux à la fois, et dans ce cas seulement, je l’intègre dans mon œuvre", déclare Segal.
(Extrait de l’article de Robert Pincus-Witten, in Cnacarchives n°5, p. 49).

La recherche d’un archétype 
Segal adopte le plâtre à la fois pour des raisons économiques mais également pour ses qualités plastiques. Les bandes de plâtre à usage médical sèchent rapidement et permettent d’obtenir à la fois une figure réaliste et le reflet d’un état intérieur. Toutefois la figure est désincarnée par la blancheur du plâtre transformant le modèle en individu anonyme. Ce parti pris permet à l’artiste de créer une certaine distance par rapport au réel. En se dégageant ainsi de toute représentation réaliste l’œuvre de Segal atteint une idée d’universel : il s’agit de l’homme en général, une sorte d’archétype de l’individu livré à l’absurdité de la banalité quotidienne.

Il y a chez les gens des attitudes enfermées dans leurs corps et qu’il faut attraper… Il arrive que des gens ne révèlent rien sur eux-mêmes et que, tout à coup, ils fassent un geste qui contient toute une autobiographie,
déclare Segal.

L’art indissociable de la vie réelle 

En général, je fais de la sculpture avec des gens que je connais très bien, disait Segal, et dans des situations où j’ai l’habitude de les voir. Qu’il faille pour ça un bloc-cuisine, un autre endroit dans la maison ou n’importe quel endroit où j’ai l’habitude d’aller : des postes à essence, des arrêts d’autobus, des rues, des bâtiments de ferme, dans tous les cas, il faut que ce soit en rapport avec ce que je connais. C’est dans ce cadre-là que je vis… Pour moi, tout ça constitue un énorme réservoir de matière artistique…
(Extrait de l’article de Robert Pincus-Witten, in Cnacarchives, p.49).

Les environnements et les sculptures de Segal sont indissociables de sa propre expérience.
Après avoir découvert les bandes de plâtre nouvellement fabriquées par la marque Johnson & Johnson, il fait sa première sculpture de moulage en plâtre sur son propre corps (
L’homme assis à une table, 1961), et sa femme Helen est pendant longtemps son principal modèle féminin. Ainsi, les modèles de ses sculptures sont choisis parmi les membres de sa famille ou le cercle de ses amis proches. Segal raconte, dans un entretien, qu’avant de commencer une sculpture, il prend le temps de dialoguer et d’observer longuement les attitudes de son modèle. Celui du moulage de la caissière n’est autre que sa propre nièce : Susan Kutliroff, aujourd’hui secrétaire et trésorière de la Fondation George et Helen Segal.
Situations humaines 
Les premiers environnements de Segal caractérisés par l’isolement d’une figure dans un univers banal ne sont pas sans évoquer les œuvres de Edward Hopper dans lesquelles l’individu apparaît accablé par une solitude désarmante dans une atmosphère lourde et oppressante.
George Segal choisit des situations humaines caractérisées par des gestes de la vie quotidienne : une femme se rasant les jambes, une serveuse de bar, une caissière de cinéma distribuant un billet. Son intérêt porte plus précisément sur la condition humaine dans la société moderne contrairement aux artistes Pop qui ironisent à partir des clichés de la société de consommation. Toutefois, l’œuvre de Segal ne se limite pas à un certain réalisme social, elle véhicule par là même une dimension métaphysique.
La découverte des moulages en plâtre dans les environnements de Segal inspirent souvent une vision à la fois morbide et fascinante. Les personnages semblent avoir été saisis dans leur immédiateté comme les corps pétrifiés des habitants de Pompéï

. Or les modèles de Segal sont bien vivants, issus de son entourage proche et pourtant limités dans leur finitude. Ce qui amène Allan Kaprow, dans un article qu’il consacre à Segal, à qualifier ses sculptures de "vital mummies" (momies vivantes).
L’expérience du happening 
Dés la fin des années 50, Segal, par l’intermédiaire de son ami Kaprow est en contact avec les premiers happenings organisés à la Reuben Gallery. Kaprow est le théoricien de cette nouvelle expression où l’art et la vie sont confondus. En 1958, dans un célèbre article intitulé "L’héritage de Jackson Pollock" (Cf. l’article de Kaprow dans les Annexes), il analyse les drippings de Pollock comme un dépassement des limites du tableau vers l’espace de la vie réelle. Ce texte précurseur est fondamental car il annonce tous les mouvements d’avant-garde des années 60. Segal découvre, grâce à son ami, une nouvelle approche de l’expressionnisme abstrait en prise avec le réel. Il est fortement impressionné par cet art revitalisé par une action se déroulant en temps réel, bien qu'il soit en même temps réticent à l’aspect éphémère du
happening. Segal assiste et participe à plusieurs happenings dans la Reuben Gallery fréquentée, entre autres, par ses amis Claes Oldenburg et Larry Rivers.
La conception des environnements de Segal résulte sans aucun doute de la synthèse entre les idées de John Cage

, pour lequel "même le banal a un potentiel esthétique", et du happening de Kaprow, fidèle auditeur de ce dernier mais aussi de la théorie d’Hofmann sur la spécificité de l’espace de la création plastique fondée sur la confrontation du fond et de la forme.
Panique à South Brunswick
En 1958, Kaprow réalise son premier happening dans la ferme de Segal à l’occasion d’un pique-nique organisé pour les membres de la Hansa Gallery. Le projet n’est pas tout à fait satisfaisant pour Kaprow qui, au départ, souhaitait faire une intervention mettant en scène des individus armés de branches et de bâtons contre une rangée de bulldozers. Sur les conseils de Segal les engins sont remplacés par des voitures moins dangereuses.
L’influence du travail de Robert Frank 
Lorsque Segal fait la connaissance de
Robert Frank par l’intermédiaire des artistes de la Hansa Gallery en 1960, le photographe vient de commencer une carrière de cinéaste. Deux ans auparavant, il publiait un livre de photographies qui allait faire scandale aux Etats-Unis. Cet ouvrage intitulé
Les Américains, composé d’une sélection de 83 clichés en noir et blanc, représente la vie quotidienne aux Etats-Unis au milieu des années 50. Il montre une image de l’Amérique sans fard, où toute la société américaine semble mise à nu et dévoilée au quotidien. Après son film manifeste
Pull my Daisy (1959) qui marque le début du cinéma d’avant-garde des années 60, Frank est à la recherche d’un lieu de tournage pour son futur film
The Sin of Jesus (
Le Péché de Jésus).
Le Péché de Jésus de Robert Frank
Le scénario du Péché de Jésus était tiré d’un récit d’Isaac Bashievis Singer. Le film, qui se déroule à Moscou, raconte l’histoire d’une pulpeuse femme de chambre qui demande à Jésus de l’aider à contenter son appétit sexuel, qu’elle satisfait souvent. Jésus lui envoie un ange pour mari, mais, dans la fièvre de la nuit de noces, la femme se jette sur lui et le tue. Le péché de Jésus, selon la morale de l’histoire, est d’avoir condamné l’infortunée à retourner à sa vie de pécheresse. Le réalisateur a utilisé les plumes des poules de Segal pour la confection des ailes de l’ange.
George Segal lui propose d’utiliser les locaux de sa ferme récemment transformés en studio d’artiste. Le tournage prévu pour quelques semaines dure 6 mois. Segal fait le recit de cette expérience en témoignant de l’extrême précision du réalisateur pour le choix des décors, la texture des matériaux. Il affirme que c’est auprès de Robert Frank qu’il eut l’idée de mettre en scène des objets réels avec des sculptures en plâtre. Toutefois, le long séjour de Frank dans la ferme de Segal nous permet de faire l’hypothèse suivante : l’influence de Robert Frank ne se limite pas au souci du décor. Segal s’est sans doute beaucoup intéressé au livre
Les Américains, pour y puiser non pas des thèmes mais une approche de la condition humaine.
La sensation d’immédiateté et l’attitude des sculptures de plâtre (sorte de négatif de la sculpture), sa vision de la condition humaine le rapprochent de la sensibilité des photographies de Robert Frank qui, à l’instar de Segal, capte des fragment de vie.